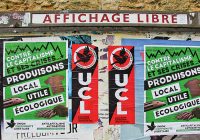Il est l’anti-Christophe Guilluy. Là où le contempteur des métropoles se fait l’avocat de la France périphérique sacrifiée sur l’autel de la mondialisation, Jacques Lévy met en avant l’ouverture à l’autre qui serait la marque des cœurs d’agglomération. Une « urbanité » qu’il oppose à l’entre-soi des territoires périurbains.
Parmi les premiers, le géographe a pointé la cassure électorale apparue lors du référendum de 1992 sur le traité de Maastricht. Un diagnostic confirmé à l’occasion de la consultation de 2005. Plus les électeurs sont éloignés des centres urbains, plus ils disent « non » aux textes européens. Une équation que le lauréat l’an dernier du Prix international Vautrin-Lud, équivalent du Prix Nobel en géographie, a également mis au jour pour le vote FN. Mais, à rebours de Christophe Guilluy qu’il a qualifié cet automne sur France Culture d’« idéologue-géographe du Rassemblement National » avant de modérer son propos, Jacques Lévy ne voit pas, là, le signe d’un abandon des pouvoirs publics.
« L’Etat-providence s’est renforcé en France en multipliant la part du produit intérieur brut (PIB) soumise à redistribution par plus de trois entre les années 1950 et aujourd’hui, pour atteindre 56,2 % du PIB en 2016 », pointe-t-il dans son dernier ouvrage (« Théorie de la justice spatiale » aux éditions Odile Jacob) coécrit avec Jean-Nicolas Fauchille et Ana Povoas. A l’occasion d’un entretien-fleuve accordé à La Gazette , Jacques Lévy passe au crible les nouveaux (dés)équilibres territoriaux.
- Périurbain : « Des revenus au-dessus de la moyenne »
- Gilets jaunes : « C’est la Grande Peur de 1789 »
- Les centres urbains, reflet des « classes créatives »
- Banlieues : « Des maires ont concentré les pauvres »
Périurbain : « Des revenus au-dessus de la moyenne »
Pourquoi considérez-vous qu’habiter les territoires périurbains ne constitue pas une assignation à résidence comme le soutiennent des « gilets jaunes » et le géographe Christophe Guilluy, mais, tout au contraire, correspond à un choix raisonné ?
Les 25 % de Français qui habitent la couronne des aires urbaines, c’est-à-dire les parties de ces aires les plus éloignés du centre, ont des revenus qui se situent au-dessus de la moyenne nationale. Ils ont, pour la plupart, fait le choix de devenir propriétaires d’une maison individuelle avec un jardin privatif, une ou plusieurs voitures. Cette décision leur coûte cher. Mais elle est pour eux une manière de ne pas rencontrer des personnes qu’ils jugent indésirables. L’objectif consiste à retrouver des gens comme soi. Les lotissements du périurbain sont très homogènes. C’est ce qu’Eric Charmes appelle la « clubbisation ». Ce modèle social repose sur des familles avec un ou plusieurs enfants. Cette duplication mimétique favorise l’entraide entre voisins qui compense l’absence de services.
Ces populations n’ont-elles pas été délaissées par les pouvoirs publics ?
L’abandon des territoires périurbains est une légende. Une antienne des sénateurs et des élus des zones à faible densité qui bénéficient plutôt du système, mais trouvent que ce n’est jamais assez. Contrairement à ce que dit Christophe Guilluy, ce sont les contribuables des grandes villes qui paient pour les autres. Le revenu disponible effectif médian le plus faible se trouve en Ile-de-France. Cela signifie que les salariés de l’aire urbaine de Paris produisent beaucoup, mais que tout est redistribué par la grande machine de la fiscalité, des retraites et de la sécurité sociale. Malgré le coût plus faible de la mobilité, la vie est globalement plus chère en Ile-de-France, en particulier le logement, bien sûr, et tout ce qui est affecté par le prix du sol. Les pauvres des régions riches paient pour les riches des régions pauvres.
Les salariés de l’aire urbaine de Paris produisent beaucoup, mais tout est redistribué par la grande machine de la fiscalité, des retraites et de la sécurité sociale
Les territoires périurbains ont tout de même subi un désengagement de l’Etat à travers la réforme de la carte militaire, la fermeture de perceptions ou le développement des déserts médicaux…
Prenons ces sujets les uns après les autres. Il y a eu, c’est vrai, la réforme de la carte militaire. Mais la guerre est finie. Il n’y a plus de service militaire obligatoire. Que les perceptions ou les trésoreries disparaissent est aussi dans l’ordre des choses. Tout est numérisé. La présence, à côté des perceptions, des trésoreries était un gâchis d’argent public innommable. Des petites maternités ferment parce qu’elles ne sont pas sûres. Il ne faut plus réfléchir en distance kilométrique des services publics, mais en temps d’accès. Il y a autant de « déserts médicaux » dans des banlieues que dans le périurbain ou les campagnes reculées. Le problème tient à ce que le système de santé est perclus de corporatismes divers, comme le dispositif à deux secteurs qui pousse les médecins à rechercher des concentrations de patients solvables.
Gilets jaunes : « C’est la Grande Peur de 1789 »
Comment expliquez-vous alors la fronde des « gilets jaunes » ?
Les « gilets jaunes » coïncident avec la part de la population la plus dépendante de l’automobile qui considère que la route lui appartient. C’est la goutte d’essence qui a mis le feu aux poudres. Mais on sait maintenant que la destruction des radars s’est accélérée avec la mise en place de la limitation de vitesse à 80 km/heure. Une partie des automobilistes rêvent d’un monde où l’Etat ne se mêlerait pas de leurs affaires. Ils refusent de prendre en compte les biens publics, notamment écologiques, qui concernent la société dans son ensemble. Ils sont libertariens. Les « gilets jaunes » sont aussi, pour une part, une extension radicalisée de l’électorat populiste qui se méfie de l’Europe et de la mondialisation en jugeant que « c’était mieux avant ».
Les « gilets jaunes » constituent-ils une classe sociale ?
Plutôt qu’un groupe sociologique, ils forment un groupe politique fondé sur un projet de démocratie directe radicale. La possibilité de révoquer les élus via le référendum d’initiative citoyenne constitue une machine de guerre contre la démocratie représentative, et cette approche à un fort pouvoir fédérateur.
Les habitants du périurbain sont-ils la seule composante des gilets jaunes ?
Non, il y a aussi un autre segment, numériquement moins important que le périurbain, l’infra-urbain (NDLR : rural profond) qui représente 4 % de la population où ils sont particulièrement bien représentés. Il y a là proportionnellement beaucoup plus de pauvres que dans le périurbain, avec notamment une population âgée ou des chômeurs qui ont renoncé au marché du travail et se débrouillent pour survivre avec peu de moyens monétaires. C’est la France du « Bon coin ». Ces personnes très isolées ont trouvé une sociabilité avec les réseaux sociaux et le mouvement des gilets jaunes.
Peut-on parler de jacquerie à propos de cette fronde ?
Les gilets jaunes sont à la fois libertariens et étatistes, héritiers de la France paysanne. La multiplication, ces dernières semaines, de fausses rumeurs sur les réseaux sociaux me fait penser à la Grande Peur de l’été 1789. A l’époque, circulait le bruit selon lequel les seigneurs allaient se venger des premières semaines de la Révolution en s’attaquant aux paysans. Comme pendant la Grande Peur, il y a, aujourd’hui, très peu de foyers qui sont à l’origine des rumeurs. Mais ces bruits se répandent comme une trainée de poudre. Dans la Grande Peur, l’idée était de prendre les devants et de brûler les châteaux et les titres seigneuriaux.
Pourtant, la France n’est plus paysanne…
Oui, mais chez nous, l’exode rural a été beaucoup plus tardif qu’ailleurs. Au lendemain de la Commune de 1871, face à des villes turbulentes qui menaçaient l’ordre social, la IIIe République a assis son autorité en faisant alliance avec les notables ruraux. Ce monde-là bénéficie toujours d’une forte présence politique. On se souvient par exemple que des agriculteurs avaient saccagé en 1999 le bureau de la ministre de l’Environnement, Dominique Voynet et ont bénéficié d’une totale impunité.
Au-delà de l’Etat, les « gilets jaunes » s’attaquent aux métropoles mondialisées de Paris, Bordeaux ou Toulouse…
Les « Gilets jaunes » comprennent une part importante d’artisans, de petits entrepreneurs ou de commerciaux. Si on reprend la classification de Pierre Bourdieu, ils possèdent plus de capital économique que culturel. Il y a chez eux, le sentiment, plus ou moins diffus, que le capital culturel, qui se traduit par un regain d’intérêt pour les villes, a gagné la partie et qu’ils sont donc les victimes de cette transformation.
N’ont-ils pas été aussi bannis de ces villes à cause de l’explosion des prix du logement ?
Non. Dans le sillage du monde ouvrier des villes issu de la culture paysanne, ces habitants ont profité de l’amélioration de leur pouvoir d’achat pour s’acheter une maison avec jardin. Ils ont ainsi réalisé leur rêve. Il y a eu un chassé-croisé plutôt qu’une logique d’éviction.
Il y a chez les « Gilets jaunes », le sentiment que le capital culturel, qui se traduit par un regain d’intérêt pour les villes, a gagné la partie et qu’ils sont les victimes de cette transformation.
Les centres urbains, reflet des « classes créatives »
Pourquoi les populations aisées ont-elles réinvesti les centres urbains ?
Il faut en effet se souvenir que dans les années 1950, on pouvait s’acheter pour un prix modique un appartement dans le Marais, en plein cœur de Paris, parce que le quartier était vétuste. Mais le plan, dans les années 1960, du ministre de la Culture André Malraux a été un moment d’inflexion. On a découvert que l’on pouvait conserver le patrimoine tout en le modernisant. La mort, en 1974, du président Georges Pompidou a sauvé Paris car, avant sa disparition, était programmé un plan de plusieurs autoroutes à l’intérieur même de la capitale. Cela passait notamment par la destruction du canal Saint-Martin de la Bastille à la porte de Pantin. Le marketing et les campagnes de pub, très dynamiques de la RATP ont aussi contribué à inverser la vapeur. Le métro, qui était considéré comme le moyen de transport des pauvres, est devenu « tendance ». Aujourd’hui, les « gilets jaunes » disent en substance : « Vous les bobos, vous avez le métro, nous, on est obligé de prendre notre voiture ! »
En quoi la renaissance des villes correspond-elle aussi à une mutation du capitalisme ?
L’ingénieur et le cadre de direction qui géraient les ouvriers taylorisés ne sont plus au cœur du système. Avec eux, a disparu le modèle des grandes résidences à l’américaine des années 1960, comme au Chesnay-Rocquencourt (Yvelines), avec Parly 2 et son centre commercial. Une matrice qui nécessitait, là encore, de créer de nouvelles autoroutes. Mai 1968 a, au contraire, projeté sur le devant de la scène des « classes créatives » dans la publicité et le cinéma hier, le numérique aujourd’hui. Comme leur intitulé l’indique, les « bourgeois-bohème », dont l’activité se situe au cœur des villes, ne sont pas des bourgeois classiques. À Paris, ils ont préféré habiter des quartiers où la population est mélangée plutôt que dans le XVIe où, il y a quelques années, des habitants en sont venus aux mains pour ne pas accueillir un centre d’accueil pour personnes précaires.
La mort, en 1974, du président Georges Pompidou a sauvé Paris car, avant sa disparition, était programmé un plan de plusieurs autoroutes à l’intérieur même de la capitale.
Mais la gentrification n’a jamais été aussi forte à Paris…
Il y a aussi 300 000 pauvres sur deux millions d’habitants. Cela situe Paris dans la moyenne des grandes villes françaises. Il y a, d’ailleurs, autant de pauvres à Paris que dans tout l’ensemble infra-urbain. Principalement composée d’étrangers et de migrants, la pauvreté est même plus intense qu’ailleurs. Ce qui ne veut pas dire que la capitale ne souffre pas d’un problème de mixité. Ce qui guette les quartiers où sont implantés les bobos, c’est le syndrome du Ve arrondissement où les catégories populaires ont presque complètement disparu. On voit déjà des paubos (« pauvres-bohème ») s’éloigner et contribuer à étendre la zone centrale, d’abord vers le péricentre de Paris, puis vers la première couronne des communes de banlieue. Pour répondre à ces problèmes, il faudrait faire appel au « pognon de dingue » des aides personnalisées au logement. Le logement social est devenu une corporation. Il serait utile de mettre en place un système où le surcoût du loyer du à la localisation ne serait pas un obstacle à l’accès au logement dans les quartiers chers. Aucune opération ne devrait être soutenue par de l’argent public si elle ne contribue pas à la mixité sociale.
Banlieues : « Des maires ont concentré les pauvres »
On en est très loin dans les banlieues difficiles…
Nous sommes, dans ces territoires, face à un enjeu colossal. La question centrale, c’est l’effondrement du monde ouvrier. Tout un groupe social se retrouve désaffilié, marginalisé par les mutations du système productif. Les enfants d’ouvriers conservent les valeurs masculines de leurs parents, le mépris du travail intellectuel, un certain goût de la violence et une sexuation dure. De ce point de vue-là, la sociologie du Nord-Pas-de-Calais ressemble à celle des banlieues « maghrébines ». Quelles perspectives offre-t-on aux héritiers d’un monde qui n’a plus de sens ? Face à cela, la « politique de la ville » paraît un peu décalée… Les zones franches urbaines ne sont pas une bonne réponse non plus car elles partent du principe selon lequel l’idéal pour un jeune de banlieue serait qu’il reste sur place, alors qu’il habite une grande agglomération et qu’il faudrait au contraire l’aider à profiter de l’ensemble de ses ressources. On ne répond pas au problème des habitants des banlieues en les confortant dans des logiques d’auto-enfermement.
Les enfants d’ouvriers conservent les valeurs masculines de leurs parents, le mépris du travail intellectuel, un certain goût de la violence et une sexuation dure. De ce point de vue-là, la sociologie du Nord-Pas-de-Calais ressemble à celle des banlieues « maghrébines.
Les maires ont-ils leur responsabilité dans cet état d’esprit ?
Oui. Même si on n’est pas face à une politique volontariste qu’en Afrique du Sud, on pourrait parler d’apartheid. Des maires, pour des raisons électoralistes, ont concentré les pauvres, comme l’ont fait leurs collègues avec les riches. Il faudrait empêcher les communes de choisir leur « peuple ». C’est à l’échelle des aires urbaines que devraient être menées les politiques de mixité sociale. C’est dans ce cadre-là que l’on pourrait dissuader de créer des logements pour les pauvres là où il y en déjà beaucoup. Les communes, dans ce schéma, n’ont pas vocation à disparaître, mais à devenir, comme à Paris ou Lyon, des mairies d’arrondissement avec peut-être même un peu plus de pouvoirs et des budgets participatifs pour organiser le vivre-ensemble. Ne nous cachons pas le rôle très négatif qu’a eu la décentralisation mitterrandienne de 1982. Elle a renforcé des échelons obsolètes : la commune et le département. C’est l’un des versants très archaïque, presque pétainiste, de la pensée mitterrandienne. Ce choix de relancer des collectivités qui n’avaient plus de pertinence a coûté très cher. Il est très difficile de faire machine en arrière. Du coup, on ajoute des couches au millefeuille au lieu d’en supprimer, l’Ile-de-France avec ses cinq niveaux étant la caricature de cela. Emmanuel Macron a cependant cité la question du nombre de niveaux de collectivités, espérant que les gens s’en emparent. On peut souhaiter que cela se produise.
Cet article fait partie du Dossier
Aménagement du territoire : si on misait sur le périurbain ?
Sommaire du dossier
- Et si on misait enfin sur le périurbain ?
- Périurbain : coopération et cohésion, des moteurs de changement
- Périurbain : comment s’inventer des lendemains qui chantent
- « Pour une ville flexible qui se reconstruit sur elle-même »
- « Il faut sortir de la diabolisation du périurbain »
- « Un autre modèle se dessine dans les périphéries »
- « Avec le confinement, le modèle pavillonnaire réhabilité ? »
- Jacques Lévy : « L’abandon des territoires périurbains est une légende »
- Le nouvel âge des zones commerciales
- Aménagement commercial : « Ne plus autoriser d’implantations me semble une nécessité »
- A Belleville-en-Beaujolais, une entrée de ville modernisée et verdie
Thèmes abordés