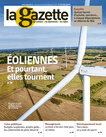Il y a les plus connus, comme “Les plus beaux villages de France”, ceux que l’on voit un peu partout sur le territoire comme “Villes et Villages fleuris” et les petits derniers comme “Petites cités de caractère”. En contrepoints des vrais atouts qu’offrent ces marques, les labels pèsent aussi lourdement sur les budgets communaux et poussent de plus en plus de villes à reconsidérer leur participation.
Un vrai outil de développement économique
Si les labels se sont multipliés ces dernières années, c’est parce qu’ils sont considérés par les communes comme un levier puissant dans leur développement économique. Pour Laurent Mazurier du label “Petites cités de caractère”, « nos 126 communes ont rejoint notre appellation pour valoriser leur patrimoine au service du développement économique. Nous aidons ces villages à promouvoir une réflexion globale sur la cité dans un contexte d’attractivité touristique. »
Même discours du côté du label des “Plus beaux villages de France” qui réunit aujourd’hui 155 villages. « Nous sommes un outil de développement local aux services des communes pour valoriser leurs atouts », explique Pascal Bernard, le délégué général. Un levier efficace à en juger par la popularité du label qui est connu par 97% des Français et la fréquentation touristique des villages labellisés, augmentant parfois de 50% à en croire l’association.
Du management et des conseils
Si Jean-Marie Plantard parle autant de la force de son label pour développer « une vraie attractivité touristique, résidentielle et économique », il donne aussi à “Villes et villages fleuries” une dimension managériale assez unique pour les 4 646 communes adhérentes. « Notre label permet aux services d’une municipalité de s’améliorer et de travailler avec d’autres entités, tout particulièrement dans les communes les mieux notées », explique-t-il en citant l’exemple de Versailles (Yvelines).
La ville, élève modèle du label, mobilise désormais les services de la voirie aux côtés des espaces verts avec une réflexion plus globale sur l’aménagement de son territoire. « Notre label offre également un outil d’analyse puissant pour permettre aux collectivités de se mettre en conformité avec la loi. L’objectif 0 phytosanitaire en 2017 nécessite de vrais conseils. Nous présentons aux communes des méthodes alternatives au tout-engrais », détaille-t-il.
A lire aussi
L’adhésion, un coût parfois important
Autant de bonnes intentions qui n’empêchent pas les communes de trouver que l’obtention du label coûte de plus en plus cher. Si le label “Villes et villages fleuris” deviendra payant pour la première fois en janvier, plafonnant la cotisation à 1 100 euros maximum, ce n’est pas le cas des “Plus beaux villages de France” qui reconnaît que le prix de l’adhésion peut être un frein.
« L’adhésion se fait au prorata des habitants. Elle va de 600 à 6 500 euros suivant la taille du territoire qui ne peut excéder 2 000 habitants », détaille Pascal Bernard. « Nous sommes plus chers que d’autres labels mais nous ne recevons pas d’aide publique » continue-t-il, contrairement à l’immense majorité des labels qui sont souvent subventionnés par le secrétariat d’Etat au Tourisme. Et d’expliciter : « C’est cher, oui, mais beaucoup moins qu’une nouvelle bordure de trottoir. »
L’après-label, un poids financier souvent trop lourd
Mais plus que l’adhésion au label, ce sont les coûts afférents pour solliciter son attribution ou pour s’assurer de son renouvellement qui font gonfler la facture. Une gageure en ces temps de disette budgétaire dont est bien conscient “Villes et villages fleuris” qui chiffre à 84 le départ des communes de son label entre 2015 et 2016. « Les communes ne peuvent plus continuer avec le même budget pour entretenir leurs espaces verts. Il faut donc changer les habitudes des agents, des élus et des habitants », explique ainsi Jean-Marie Plantard.
Les labels patrimoniaux font, eux, preuve de moins de compréhension. Pour les “Petites cités de caractère”, « la réflexion globale sur l’histoire d’un village a un coût. Mais c’est un choix de politique générale des élus qui doivent s’interroger sur leur plan local d’urbanisme. Nous refusons de faire des concessions sur l’entretien du patrimoine. C’est notamment pour cette raison que nous proposons à nos nouveaux adhérents un statut intermédiaire pendant trois ans, le temps pour eux de voir si notre label et notre vision leur correspond. Nous n’avons compté qu’un seul départ ces dernières années », précise Laurent Mazurier.
Du côté des “Plus beaux villages de France”, Pascal Bernard reconnaît que « pour rester beau, un village doit faire des efforts. Cela suppose les services de bons architectes, de bons paysagistes et de bons bureaux d’études ». «C’est un coût qui offre de vrais bénéfices aux habitants et plus largement à la collectivité. Et c’est aussi cela qui permet de garder des commerces de proximité et d’éviter à des zones entières de mourir », continue-t-il.
A lire aussi
« Les communes ne doivent pas être dans le formol »
Chaque label a beau assurer que les départs des adhérents sont extrêmement limités voire inexistants, le son de cloche n’est pas tout à fait le même du côté des associations d’élus. Si aucune d’entre elle n’a accepté de répondre en son nom propre, plusieurs ont souligné que de nombreuses défections de communes pourraient intervenir dans les prochaines années.
A Saint-Lizier (Ariège) qui a cessé d’appartenir aux “Plus beaux villages de France” fin 2013, le territoire « n’avait pas les moyens de réaliser les travaux nécessaires au maintien dans l’association », explique le maire, Etienne Dedieu. « Ils auraient coûté entre 700 000 et 1 million d’euros » – un montant inaccessible alors que la dette communale s’élève à 4 millions d’euros, précise l’édile.
A Treignac (Corrèze), c’est la création d’une zone artisanale à l’entrée du village qui a poussé la commune à quitter d’elle-même les “Plus beaux villages de France” en 2008. Pas question, pour appartenir au label, de posséder « une zone d’activité et pavillonnaire très laide » comme le dit sans détour Pascal Bernard. « Nous poussons les communes à se retirer elles-mêmes quand elles ne sont plus au niveau. Nous devons poser des règles pour que les villages continuent de vivre. Pas question de laisser des zones mourir en laissant des communes se dégrader. »
Dans l’une des plus grosses associations d’élus, ces propos mettent en colère. « C’est exactement pour cela que de plus en plus de communes pensent à quitter les labels. Elles ont assez d’être dans le formol. Il est temps qu’on nous laisse organiser le développement économique tout en ayant confiance en nous. Nous n’allons pas saccager nos communes. » A voir certaines entrées de villes, l’équilibre n’est manifestement pas si facile à trouver…
Cet article fait partie du Dossier
Classements et labels touristiques : comment ne pas les subir
Sommaire du dossier
- Les classement Unesco et labels touristiques sont-ils des coups gagnants pour le développement économique ?
- L’Etat se veut régulateur du patrimoine mondial Unesco classé en France
- Tourisme : Le patrimoine immatériel est encore négligé par les pouvoirs publics
- L’investissement dans le tourisme de patrimoine rapporte plus de vingt fois la mise
- Les labels touristiques : des atouts et des coûts
- Patrimoine culturel : ce qui va changer pour les collectivités territoriales
- A Dijon, la labellisation de l’Unesco permet la création d’emplois
- La Roche-sur-Yon mise sur son passé napoléonien pour développer le tourisme
- Les visiteurs étrangers, enjeu essentiel du développement touristique
- Tourisme : « Il faut capitaliser sur des marques fortes qui sont capables d’entrainer tout un territoire »
- Tourisme international : la diversification des projets est un facteur de réussite
- « La notion de tourisme international n’est pas uniforme » – Nathalie Fabry
- « Les territoires souffrent de politiques événementielles pauvres »
- Tourisme international : façonner son image pour faire mouche auprès de la bonne clientèle
Thèmes abordés