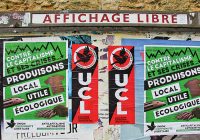L’attractivité d’un lieu touristique dépend de la qualité de son écosystème naturel. Une évidence qu’a tenu à rappeler l’association environnementale eco-union dans son rapport Blue Tourism, paru le 20 juin et réalisé en partenariat avec l’Institut du Développement Durable et des Relations Internationales (Iddri).
Le document a été dévoilé à l’occasion du premier « forum sur le tourisme bleu », organisé à l’Agence française de développement (AFD) par eco-union en partenariat avec l’Iddri, l’AFD et l’Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie (ADEME). Un moment de dialogue entre les acteurs du tourisme maritime et côtier, engagés dans une démarche de durabilité.
La nécessité du changement
Les faits sont indéniables : le tourisme côtier et maritime est un secteur en pleine expansion depuis plusieurs années, comme on peut le lire dans le rapport. Mais Jérémie Fosse, le coordinateur de l’étude, rappelle que « les activités liées au tourisme bleu ont des impacts environnementaux et sociaux critiques sur les écosystèmes naturels et les communautés locales ».
Face aux défis du changement climatique et à l’urgence de la situation, une « transition vers le tourisme bleu durable est nécessaire », estime Stéphanie Bouzigues, secrétaire générale du Fonds Français pour l’environnement Mondial (FFEM). Si des acteurs de plusieurs nationalités ont répondu présents pour le forum, la France a aussi sa carte à jouer. Le tout étant de savoir à quel échelon les mesures doivent être prises : mondial, continental, national.
Réglementer pour mieux agir
« Le passage à un tourisme plus durable nécessite une collaboration entre tous les acteurs », avance Anne-France Didier, conseillère politique au Ministère de la transition écologique sociale et solidaire. Un constat partagé à l’unanimité lors du forum.
« Ce qu’il faut avant tout c’est changer la norme qui définit le tourisme bleu actuel », avance Elen Lemaitre-Curri, directrice du Plan Bleu afin d’homogénéiser les objectifs, et les pratiques, entre tous les acteurs impliqués.
Cela passe donc d’abord par l’établissement d’une réglementation, voire une fiscalité, ou un mode de financement partagés. La question de la taxation du kérosène est ainsi beaucoup revenue dans les débats. Alors que certains pays comme la Suisse la pratiquent déjà sur les vols intérieurs, les députés français ont rejeté, le 15 juin, des amendements au projet de loi mobilité qui auraient pu instaurer une telle mesure. A l’échelle européenne, la taxation des vols internationaux est encore discutée et le kérosène n’est actuellement que très peu, ou pas du tout, taxé à ce titre.
Réguler le tourisme doit « avant tout se faire à l’échelle mondiale », défend Jérémie Fosse. Aussi bien l’Accord de Paris sur le climat que le Programme des mers régionales sont des exemples de conventions transnationales qui comportent un volet « tourisme » et pour lesquelles la France s’est engagée. Pour rappel, la France est le seul pays au monde qui possède des récifs sur les trois océans.
Verdir l’industrie touristique
Certains acteurs en étroite relation avec le tourisme bleu n’ont pas attendu les lois pour commencer à penser un tourisme bleu durable. L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) a par exemple développé une stratégie de tourisme durable en Nouvelle-Aquitaine, qui passe par l’usage d’écolabels.
Ceux-ci sont également plébiscités par les acteurs du privé qui tentent une conversion. Le Groupe Pierre et Vacances-Center Parcs propose ainsi 50 sites labellisés « Clef verte », signifiant leur entrée dans une démarche de durabilité.
Plus généralement, les hôtels, sociétés de croisières et autres opérateurs touristiques sont invités à « verdir leurs pratiques, en utilisant moins de plastique ou en améliorant leur gestion de l’eau par exemple », a avancé Jérémie Fosse.
Depuis quelques années déjà, c’est « l’éco-tourisme » qui porte cette nouvelle approche du tourisme et contribue à la « conservation de la nature et à la vie de la communauté locale dans des zones dotées d’écosystèmes de grande valeur », peut-on lire dans le rapport d’eco-union. De plus en plus populaire, cette vision du tourisme « gagne à être élargie » commente Jérémie Fosse.
Les citoyens et la science au service de l’environnement
Mais piloter le développement du tourisme bleu durable nécessiterait de mieux mesurer ses impacts, à travers la construction d’indicateurs qui font aujourd’hui encore, trop souvent défaut.
Les participants du forum ont en outre défendu à l’unanimité l’intérêt des sciences pour assurer la conversion. D’autant qu’elles ne sont pas forcément réservées aux spécialistes. Le groupe Pierre et Vacances-Center Parcs développe par exemple des activités de sciences participatives depuis 2010, date de la première expérimentation en Moselle. « C’est notre responsabilité de sensibiliser les touristes à leur environnement », déclare Marie Balmain, directrice du Développement Durable pour le groupe, en l’occurrence en leur demandant de récolter des données sur les sites qui accueillent leurs séjours.
La démarche des sciences participatives contribuerait à « transformer les citoyens en acteurs du la préservation des écosystèmes marins » selon Jean-Pascal Quod, président de Reef Check France, un programme d’éducation et de suivi de l’état de santé des récifs coralliens. Car pour comprendre notre environnement, « il faut collecter des données, et ça tout le monde peut le faire », affirme Laurent Debas, chargé de programme pour l’association Planète Mer.
Cet article est en relation avec le dossier
Thèmes abordés