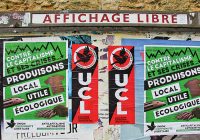Si la métropolisation est un « processus nécessaire de renforcement des dynamiques économiques mais aussi de la cohésion sociale » du pays, aux yeux de l’Association des directeurs généraux des communautés de France, le dernier ouvrage scientifique publié sous son patronage et coordonné par son délégué général, David Le Bras, jette un pavé dans la mare, pointant le manque de réflexion analytique dans le dernier acte de la décentralisation.
L’ouvrage, intitulé « Métropoles en chantiers », contient en particulier quelques analyses assassines sur la métropole du Grand Paris, notamment celle d’Antoine Valbon, rien moins que l’un des directeurs généraux de son douzième établissement public territorial (Grand Orly Val-de-Bièvre Seine-Amont).
Selon lui, les porteurs du projet de la MGP la présentent comme une réponse à tout alors que les réflexions ne sont pas allées jusqu’au bout, voire n’ont pas été entamées : « À aucun moment, ni la loi ni les débats parlementaires n’ont défini, analysé, appréhendé ou critiqué le fait métropolitain. Les travaux et recherches universitaires d’historiens, de géographes, de sociologues d’économistes n’ont pas été mobilisés dans le processus législatif. Il n’y a pas eu d’étude d’impact de la création de la métropole du Grand Paris, que ce soit en amont ou en aval. À l’aune de la COP 21, les conséquences de la course au gigantisme n’ont pas été regardées. ‘Big is beautiful’ est la nouvelle doxa », condamne le délégué de l’ADGCF pour l’Île-de-France.
Au détriment des habitants
Valbon critique le fait que l’opposition historique entre la petite couronne, « territoire servant de la capitale », et Paris, n’a pas été prise en compte, alors que des « villes capitales » accueillant universités, théâtres et musées se sont construites en banlieue dans les années 70 et 80, avant de péricliter en même temps que l’activité industrielle dans la région.
Et pas forcément au profit des habitants du territoire, comme le démontre Frédéric Gilli, chercheur à l’École urbaine de Sciences Po, et auteur d’un chapitre sur le « déficit de développement économique de l’Île-de-France » : si la métropole parisienne est l’une des plus dynamiques en Europe, avec 3,7 % de croissance annuelle sur la valeur ajoutée entre 2000 et 2011, c’est aussi l’une de celles où la croissance de l’emploi est la plus faible, à 0,4 % par an contre 1 % en moyenne européenne, soit un manque à gagner de 400 000 postes.
D’où la critique émise par Antoine Valbon de la métropolisation comme un simple « processus de dynamiques économiques et financières », dont les conséquences sur les populations ne sont pas prises en compte dans la politique de l’habitat.
Que faire des populations peu qualifiées, comment les catégories sociales vont-elles se répartir dans espace ? Des questions non débattues, qui expliquent que « le projet métropolitain et la démocratie métropolitaine sont aujourd’hui peu identifiables », assène-t-il.
« On en viendrait même à se demander si la métropole ne serait finalement pas la forme la plus antinomique aux lois de décentralisation des années 1980 », conclut-il en pied de nez aux promoteurs de l’acte III de la décentralisation.
« Métropoles en chantiers » contient également plusieurs chapitres très instructifs sur la construction d’autres métropoles françaises (Lyon, Marseille, Grenoble, Nantes, Lille), ainsi qu’une critique du biais analytique consistant à ne penser le développement économique des métropoles que par les emplois « supérieurs », dans les secteurs dynamiques et innovants, en évacuant le reste de l’activité productive, « au risque de passer à côté d’une meilleure compréhension des dynamiques productives au sein des métropoles, mais également dans l’interaction entre les métropoles et leur hinterland », explique Magali Talandier, coordinatrice de l’ouvrage et maître de conférence à l’université de Grenoble-Alpes.
Cet article est en relation avec les dossiers
Thèmes abordés
Régions