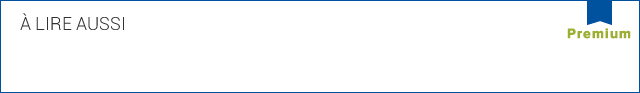Quartiers prioritaires : douze mois pour transformer la politique de la ville
Les chantiers de la politique de la ville n’ont pas pris fin au 31 décembre dernier, date butoir pour la signature des nouveaux contrats de ville. Afin de répondre, par des « mesures de fond », aux divers attentats ayant endeuillé 2015, un projet de loi « égalité et citoyenneté » articulé autour du logement, mais abordant aussi l’insertion professionnelle comme la médiation sociale, devrait être examiné en février au Parlement.
Un troisième comité interministériel sera organisé au printemps. L’objectif de ce comité est de s’assurer que les annonces gouvernementales sont effectivement traduites en actes par les collectivités, car les promesses portées par la politique de la ville « ne produiront des effets que si elles sont appliquées », explique Patrick Kanner, ministre de la Ville.
Mobilisation – En parallèle, le bloc local devra consolider les contrats de ville avec l’aide des préfets pour en faire de véritables projets de territoire intégrés et participatifs, seule chance d’améliorer les situations économiques et sociales des habitants des quartiers prioritaires. En dépit de l’optimisme affiché par le ministère de la Ville, les professionnels restent vigilants sur le terrain : la mobilisation des politiques et des moyens de droit commun doit être concrétisée. Le plus dur ne fait que commencer.
Logement : davantage de mixité sociale grâce aux attributions
Annoncé en mars 2015, après les attentats de janvier, le projet de loi « égalité et citoyenneté » devrait être envoyé pour examen au Conseil d’Etat en janvier et présenté en conseil des ministres avant la fin du premier trimestre. Il devrait avoir une forte tonalité « logement » : l’objectif est d’améliorer la mixité sociale des quartiers prioritaires.
Arrêtés de carence – Les principaux leviers sont l’amélioration de la mise en œuvre de la loi « SRU » et une attribution des logements sociaux assurant une meilleure répartition des foyers les moins favorisés sur l’ensemble du territoire intercommunal, notamment liée à une remise à plat de la politique des loyers. L’application de la loi « SRU » repose sur des critères exclusivement démographiques. Il est question de les tempérer à la marge par des critères permettant de qualifier la pression de la demande (nombre de demandeurs de logements et d’attributions réalisées), ce qui, selon le ministère, n’aurait qu’un faible impact sur les communes concernées. Par ailleurs, la prise des arrêtés de carence au titre du non-respect de l’article 55 de la loi « SRU » resterait l’apanage du préfet de département. Une harmonisation des critères se ferait malgré tout aux niveaux national et régional.
Le volet de remise à plat de la politique des loyers est plus complexe : le texte viserait à libérer les bailleurs des contraintes de plafonds de loyers, en posant des garde-fous. La compensation des loyers baissés pourrait être globale, et non logement par logement comme aujourd’hui. Le texte fait plutôt consensus, mais le caractère technique de nombreuses dispositions en complique la rédaction.
Education : secteurs multicollèges, l’année test
La mixité sociale au collège est à la peine. Avec 70 collèges (1 %) qui accueillent plus de 82 % de collégiens d’origine sociale défavorisée et, à l’opposé, 700 (10 %) qui reçoivent plus de 42 % de collégiens d’origine sociale très favorisée, les 7 075 établissements présentent une très forte hétérogénéité.
Départements pilotes – Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Education nationale, ambitionne de faire évoluer les secteurs de recrutement des établissements. Prudente, elle s’est contentée d’une expérimentation, lancée en novembre 2015, avec le concours de 17 départements pilotes. Ceux-ci sont volontaires pour tester la mise en place de secteurs multicollèges.
Des chercheurs appuieront la démarche localement et s’assureront de l’instauration d’un protocole d’évaluation. Au second trimestre, les familles des secteurs multicollèges seront amenées à faire leur choix d’établissement. Les solutions envisagées par les départements devront être opérationnelles dès la rentrée 2016. Une évaluation nationale permettra d’identifier les dispositifs les plus efficaces en vue de leur essaimage.
Sécurité : les acteurs locaux mobilisés par la lutte contre le terrorisme
La lutte contre le terrorisme s’est imposée de façon massive dans les politiques publiques après les attentats de janvier et du 13 novembre 2015, dépassant largement l’action policière et judiciaire. C’est le sens du « pacte de sécurité » voulu par le président de la République et qui mobilise l’ensemble des acteurs locaux.
Les collectivités sont appelées à jouer un rôle central dans les dispositifs de prévention de la radicalisation, notamment les cellules départementales de suivi qui sollicitent, entre autres, autour du préfet et du procureur de la République, les professionnels de l’action sociale.
A cet effet, la formation des agents pour détecter les signaux faibles de la radicalisation et coordonner leurs réponses avec les partenaires locaux constituera, sans aucun doute, l’un des enjeux majeurs des prochains mois.
Accès aux fichiers de police – De même, à la demande du gouvernement, les exécutifs locaux sont incités à intégrer des actions de prévention de la radicalisation dans leurs plans locaux. Dans cette perspective, l’enveloppe du fonds interministériel de prévention de la délinquance bénéficiera cette année d’un abondement conséquent dédié à la lutte contre la radicalisation. Reste à déterminer quelles actions mobiliser. Et pour quelle efficacité ?
Enfin, l’année 2016 devrait confirmer le rôle croissant des policiers municipaux dans la chaîne des forces de sécurité. Les PM, dont les moyens de protection et de défense ont été considérablement revus à la hausse à la suite des attentats, seront autorisés dans les prochains mois à accéder à certains fichiers de police.
Cet article est en relation avec les dossiers
- La nouvelle politique de la ville convient-elle aux habitants autant qu’aux professionnels ?
- Travail social : une nécessaire refondation
Cet article fait partie du Dossier
Les priorités des collectivités territoriales en 2016
Sommaire du dossier
- Les priorités des collectivités en 2016 : à la recherche d’une nouvelle cohésion sociale
- 2016 et réformes institutionnelles : intercommunalités, supers régions, réforme de l’Etat
- Finances locales en 2016 : Réforme de la DGF, et financement du RSA
- Ingénierie publique : les grands dossiers à suivre en 2016
- Fonction publique en 2016 : Carrières et rémunérations, déontologie, temps de travail
- Politiques de cohésion en 2016 : politique de la ville, logement, éducation, et lutte contre la radicalisation
- Simplification administrative : Les relations avec le public seront (enfin) facilitées
- Commande publique en 2016 : une boîte à outils pour les marchés
- Politiques culturelles : projet de loi « Création » et lecture publique
- Politiques sociales en 2016 : protection de l’enfance et adaptation de la société au vieillissement