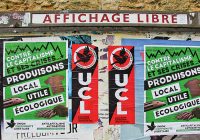Si certains libéraux préfèrent retenir les opportunités susceptibles d’être créées par un tel traité, plusieurs représentants européens des collectivités territoriales ont émis des réserves lors d’un débat organisé par le Comité européen des régions, le 8 octobre dernier à Bruxelles. Motifs : les conséquences du traité Tafta pour les PME ainsi que pour les administrations, du fait, notamment, de dispositions susceptibles de modifier les règles d’achat public.
Rien qu’en France, quatorze régions, quatre départements et près de quatre-vingt communes se sont déjà déclarés « hors Tafta » et/ou ont demandé l’arrêt des négociations. « Les collectivités sont en première ligne des impacts du traité transatlantique » s’inquiète Christophe Rouillon, maire (PS) de Coulaines et président de la commission Europe de l’Association des Maires de France (AMF).
Venus convaincre les élus locaux de leur utilité pour dégager un soutien public sur le terrain susceptible d’accélérer la signature d’un accord, le commissaire européen en charge du commerce Karel de Gucht ainsi que Anthony Gardner, l’ambassadeur des Etats-Unis pour l’Union européenne, ont été applaudi à plusieurs reprises. Mais, alors que les négociations n’associent pas jusqu’ici les élus locaux, ils ont également été mis à l’épreuve par des édiles pas forcément hostiles au libre-échange, mais issus de pays à forte tradition de services publics et craintifs à cet égard.
Ces derniers ont-ils raison de s’inquiéter des impacts du traité transatlantique sur les collectivités territoriales ? Cet accord de libre-échange va-t-il réellement réduire les marges de manœuvre des élus et des fonctionnaires territoriaux ?
VRAI
« Du jour au lendemain, les collectivités apprendront que la réglementation autour des marchés publics liés à la gestion de l’eau, des transports ou du secteur social a évolué », s’alarme Frédéric Viale, docteur en droit et juriste de l’association Attac. Outre l’ouverture de tous les marchés publics à la concurrence internationale, la crainte de ce militant tient à l’abaissement de la capacité d’action des élus locaux qui auront, en cas de signature de l’accord transatlantique, beaucoup moins de latitude pour définir les cahiers de charges des appels d’offre.
En effet, « l’introduction d’un mécanisme d’arbitrage privé investisseur-Etat, qui se substituerait aux juridictions existantes, serait un moyen pour les multinationales d’éliminer toutes les décisions publiques qui constituent des entraves à l’expansion de leurs parts de marché », analyse le département de la Seine-Saint-Denis, dirigé par Stéphane Troussel (PS). Sous peine d’être dénoncées par des candidats déboutés, les clauses de contenu social et environnemental pourraient être censurées des appels d’offres, voire celles de préférence géographique qui subsistent dans certaines collectivités sous couvert de développement durable ou de réduction de l’empreinte environnementale.
En finir avec ces exigences de qualité – comme l’approvisionnement des cantines scolaires par le biais de filières courtes favorisant l’agriculture locale – reviendrait à supprimer le caractère stratégique des marchés publics susceptibles d’orienter le développement d’un territoire, selon les anti-Tafta.
« C’est une réduction considérable du périmètre politique des élus et de leur capacité à prendre des décisions au service du développement local ou de la transition énergétique. L’accord transatlantique donne les clés de l’intervention publique et de la légitimité à agir aux seules entreprises privées », fustige Frédéric Viale.
FAUX
Parce qu’il est un accord commercial international, le traité transatlantique représente aux yeux des acheteurs publics la crainte d’un nouvel ensemble de normes venant corseter davantage les collectivités dans leur choix d’attributaires des marchés publics en leur imposant, notamment, des entreprises multinationales au détriment d’entreprises nationales, voire locales. Or, en la matière, le traité transatlantique ne vient ici que confirmer des règles européennes et nationales existantes.
Ainsi, aux élus redoutant ne plus pouvoir attribuer des marchés à des entreprises locales, Alain Bénard, vice-président de l’Association des acheteurs publics, rappelle que « la préférence locale est contraire au principe constitutionnel d’égalité et passible de poursuites pénales sur le fondement du délit de favoritisme et est également interdite au niveau européen au nom du principe de non-discrimination, comme le répète régulièrement la Cour européenne de justice dans sa jurisprudence ».
Autre inquiétude des acheteurs publics locaux : le respect de nouvelles règles sanitaires moins contraignantes que celles existantes qui s’imposeraient aux collectivités dans leurs achats d’aliments jusqu’alors interdits (bœuf aux hormones, poulet chloré, produits contenant des OGM, etc.), notamment en matière de restauration scolaire. Mais c’est oublier que les collectivités pourront toujours insérer dans leurs marchés des clauses environnementales comme le permettent aujourd’hui les articles 5 et 6 du code des marchés publics.
Ces clauses continueront ainsi de traduire leur choix de proposer un éventail assez large de produits sous le signe de la qualité, qu’il s’agisse de productions en label rouge, sous appellations d’origine mais aussi de produits locaux issus de circuits de proximité.
Enfin, la création d’un tribunal arbitral privé par le traité transatlantique pour juger de certains litiges entre entreprises et personnes publiques fait craindre aux collectivités territoriales de voir leurs marchés conclus dénoncés directement par les candidats évincés. Mais une telle compétence supranationale est loin d’être acquise à ce jour des négociations…