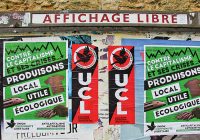Pour la première fois, en juin, l’Association nationale des DRH des grandes collectivités territoriales s’est jointe à une procédure portée par des organisations syndicales pour contester le risque d’atteinte au secret médical présent, notamment, dans l’article 7 de l’ordonnance du 25 novembre 2020 (1). Un secret médical déjà chahuté par la crise sanitaire, qui a forcé les administrations à s’ingérer davantage dans la connaissance des situations de santé des agents (vulnérabilité pour les autorisations spéciales d’absence, vaccination). Depuis, la question de la réorganisation des instances médicales et leur rapport avec les gestionnaires des ressources humaines fait débat.
Situations complexes du quotidien
« Sur ce sujet, il y a deux écoles. Les gestionnaires, qui se satisfont du système, et ceux qui souhaiteraient plus d’informations de la part du comité médical, de manière à mieux organiser leur gestion prévisionnelle des emplois », explique franchement Pascale Frery, la directrice générale adjointe aux ressources humaines de la ville de Grenoble (3 000 agents, 160 000 hab.). Bruno Jarry appartient à la seconde école. « Une meilleure approche de gestion entre la médecine et l’administration serait souhaitable. Cette dernière se sent parfois un peu démunie », confie le directeur des ressources humaines du conseil départemental de Maine-et-Loire (3 000 agents, 815 300 hab.).
Car les situations complexes du quotidien sont le lot des services RH.
« J’ai eu un agent, absent pour maladie, dont le médecin renouvelait les arrêts mois par mois. La situation a duré un an, nous obligeant à positionner tour à tour plusieurs contractuels sur le poste. Cette absence longue a produit par ricochet
[80% reste à lire]
Article réservé aux abonnés
Gazette des Communes