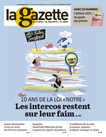Face à la « démocratie-régime » en crise, il nous faut mettre en route une « démocratie-construction ». Lente, édifiante, interactive, elle s’épanouit dans l’intervalle des élections, associe les citoyens et suscite leur pouvoir d’agir. Vouloir réduire la démocratie à un bulletin de vote une fois tous les cinq ou six ans, c’est fatalement l’exposer à l’échec et à la dérive vers une « démocratie providentielle », qui positionne l’élu dans la promesse et l’habitant dans l’attente. Ce petit jeu nourrit la vague déferlante de la frustration et du soupçon généralisé à l’égard de la politique et de ses représentants.
Dans ce contexte, la démocratie de participation constitue un enjeu de (re)fondation d’une citoyenneté active. Elle répond à l’urgence du « mieux vivre-ensemble » : il n’est de démocratie aboutie que dans la fraternité. C’est cette utopie qui nous anime à Kingersheim. Dans le cadre des états généraux permanents de la démocratie, les conseils participatifs associent habitants, partenaires, collaborateurs et élus dans la construction de tous les projets.
La démocratie participative est exigence
Dans cette démarche, la décision des élus s’appuie sur une phase de maturation et de coproduction avec les habitants. Bien plus que la décision prise, c’est le cheminement qui compte, faisant de chacun une partie intégrante de l’espace public, du bien commun et de l’intérêt général, qui nous réunissent. Dans ce cheminement se fait l’apprentissage de l’action publique, c’est-à-dire de la complexité, de la durée et de l’altérité.
C’est donc là que s’opèrent les processus de transformation sociale et personnelle. C’est là que se niche ce qui est essentiel dans la démocratie participative : l’exigence ! Elle est exigence pour les habitants. C’est dans le passage du « moi » au « nous », de l’immédiat au long terme, de l’intérêt particulier à l’intérêt général, que les individus deviennent citoyens.
C’est dans ces mutations qu’ils font l’expérience d’une démocratie où se construit ce qui fait ce qu’il y a de plus humain en l’homme, l’altérité. Cette démarche s’offre comme la véritable alternative à la dictature de l’opinion, du « dernier mot » ou du « moi d’abord », qui fleurit sur le terreau de l’ultralibéralisme et de la marchandisation des consciences.