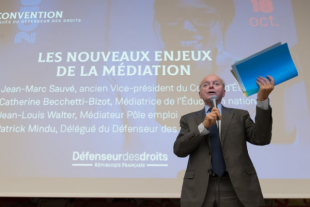Jacques Toubon, Défenseur des droits, a réuni ses 511 délégués – principale voie de saisine du Défenseur des droits – habituellement répartis sur l’ensemble du territoire pour accueillir gratuitement les personnes ayant des difficultés à faire valoir leurs droits. La 4e Convention des délégués du Défenseur des droits s’est tenue les 17 et 18 octobre. L’objectif était d’évoquer les sujets qui les préoccupent, de réfléchir à leurs missions, et de débattre de questions sur lesquelles les délégués interviennent au quotidien.
Ce que font ces délégués au quotidien, c’est traiter les réclamations qu’ils reçoivent par la voie du règlement amiable, et donc par la médiation. En 2017, 71% des règlements amiables opérés par les délégués ont abouti favorablement. En 2017, ils ont traité 70 718 dossiers, soit 77% des demandes adressées à l’institution. Et c’est autour de ce sujet de la médiation qu’ont tourné les débats de la grande réunion du 18 octobre.
La médiation préalable obligatoire suscite l’inquiétude
La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (dite loi J21), a complètement refondu le régime juridique des procédures amiables de règlement des conflits, en mettant en place une nouvelle procédure de médiation, qui permet aux parties à un litige de chercher un accord, avec l’accompagnement d’un tiers indépendant. Un rôle joué régulièrement par les délégués du défenseur des droits lorsqu’une collectivité est impliquée.
Les collectivités peuvent effectivement décider de recourir à la médiation lorsqu’elle est en conflit avec un agent, un cocontractant ou un usager, plutôt que d’aller devant le juge, « ce qui implique d’accepter une application souple du droit, avec une dose d’équité, voire d’humanité », selon Patrick Mindu, délégué du défenseur des droits et conseiller d’Etat.
Une nouvelle procédure accueillie prudemment par Jacques Toubon, Défenseur des droits : « est-ce que c’est la société qui a envie de participer au règlement de certains conflits par la médiation, ou est-ce l’institution de la justice qui se défausse vers la médiation ? »
Jean-Marc Sauvé, ex vice-président du Conseil d’Etat, a tenté de la rassurer. « Il ne s’agit pas de vider les juridictions d’un pourcentage le plus élevé possible de requêtes en créant un circuit de dérivation. L’objectif est de diversifier le mode de règlement des litiges, afin de recréer du lien social. » Pour lui, dans certaines situations, la médiation est plus adaptée qu’une procédure juridictionnelle : « L’objectif est d’ouvrir aux parties des espaces d’échanges propices aux rapprochements des points de vue, et à trouver des solutions pragmatiques, acceptable en équité et en droit pour tout le monde. Ce qui permet de préserver l’avenir des relations entre les parties mieux qu’une décision juridictionnelle. »
Une analyse qui fait consensus. Mais la loi J21 met aussi en place une expérimentation pour quatre ans de la médiation préalable obligatoire dans le contentieux de la fonction publique et dans certains litiges sociaux (notamment ceux relatif au RSA). Une expérimentation qui se concentre, en ce qui concerne les litiges sociaux, dans six départements depuis avril 2018.
Ce sont les délégués du défenseur des droits qui y jouent le rôle de tiers indépendant. Sur les 200 procédures réalisées dans ce cadre, Patrick Mindu estime que « 30 à 40% des procédures ont abouties, c’est-à-dire que toutes les parties étaient satisfaites de la solution trouvée ».
Une médiation préalable obligatoire qui peut faire peur. Un délégué a interpellé Jean-Marc Sauvé, lui demandant si cette procédure « ne transforme pas les délégués en auxiliaires bon marché du ministère de la justice. »
Une médiation numérique insuffisante ?
Cette 4e convention des délégués du Défenseur des droits fut également l’occasion pour Mounir Mahjoubi, secrétaire d’Etat chargé du Numérique, de rappeler son plan pour un numérique inclusif, lancé en septembre dernier à Nantes.
Jacques Toubon avait auparavant rappelé « cela fait quatre ans que nous posons le diagnostic que, si en 2022, on oblige les gens à accéder aux services publics par le numérique, il y aura 20 à 25% de personnes en difficulté. » Selon le Défenseur des droits, » il faut simplifier et ré-humaniser les services publics offerts aux citoyens. »
Le secrétaire d’Etat désormais rattaché à Bercy a donc dû commencer par rassurer le Défenseur des droits. « Nous n’avons pas pour objectif 100% de procédures obligatoirement réalisées sur Internet. Nous souhaitons que 100% des procédures soient réalisables sur Internet. » Pour lui, ce sont même « 40 à 50% des Français qui disent que Internet est compliqué à utiliser. » D’où son intention de simplifier les services publics en ligne.
Mais Mounir Mahjoubi est surtout venu pour insister sur le rôle que les délégués au défenseur des droits peuvent prendre dans le cadre du plan pour un numérique inclusif. « Localement, vous pouvez être des personnes exigeantes envers les collectivités territoriales. Vous pouvez notamment vous assurer que le pass numérique, dont le financement est de l’initiative des collectivités, soit bien distribué dans votre territoire. Vous pouvez également vérifier que des collectivités se portent candidates dans le cadre de l’appel à projet pour la création de hubs France connectée, qui auront pour mission de coordonner les acteurs de la médiation numérique sur l’ensemble du territoire. »