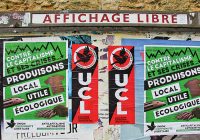Saisir les dynamiques spatiales à l’œuvre dans les métropoles grâce à l’étude minutieuse de leurs infrastructures, tel est l’objet de « Le Futur des métropoles », de Nathalie Roseau (éd. Metis Presses, février 2022). Architecte et urbaniste, celle qui a commencé sa carrière au sein de l’Etat, à la direction de l’équipement Ile-de-France en travaillant sur le schéma directeur régional avant de rejoindre la Datar, puis Aéroports de Paris, s’est tournée, au bout d’une dizaine d’années, vers l’enseignement et la recherche. Elle est à présent professeure d’urbanisme à l’école des Ponts, chercheure au laboratoire Techniques, territoires et sociétés, et anime le programme de recherche « Inventer le Grand Paris. »
Nathalie Roseau s’est penchée sur trois villes pour étudier des infrastructures héritées de grands projets d’aménagement qui mobilisent des imaginaires et semblent courir après les récits que l’on projette sur l’avenir : l’histoire du parkway à New York, qui découle d’une vision privilégiant l’aménagement de grands parcs que l’on imaginait construits pour le futur ; l’ouverture du périphérique parisien et de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, à un an d’intervalle ; l’infrastructure aérienne de la cité-Etat de Hong Kong. Autant de déclinaisons spécifiques et territoriales qui « éclairent sur les valeurs, les désirs, les attentes d’une société par rapport aux promesses des temps à venir », et qui ont connu des destins très divers.
Ce travail sur l’infrastructure confirme son « formidable pouvoir de structuration des métropoles, par ses propriétés intrinsèques autant que par son potentiel d’action », mais interroge aussi sur les controverses qui en découlent, les impensés des territoires, à l’heure de nos « présents écologiques ».
Pourquoi penser la ville à grande échelle par la porte d’entrée des infrastructures ?
Pour embrasser la matérialité des flux des grandes villes. Les ouvrages par lesquels ils se déploient – voies, plateformes, terminaux, trottoirs – affectent la ville, la façonnent. En plus d’être technique, l’infrastructure est sociale et politique. Elle peut être utilisée au quotidien par des millions d’urbains. Elle est le fruit de relations de pouvoir avec diverses représentations et stratégies à l’œuvre.
C’est donc aussi un prisme pour saisir les temporalités et les imaginaires : comment la société projette-t-elle le futur et que réalise-t-elle, in fine, sur une échelle qui se compte généralement en plusieurs décennies ? Je considère le temps comme matériau du projet, à la fois futuriste et obsolescent,
[60% reste à lire]
Article réservé aux abonnés
Gazette des Communes
Thèmes abordés