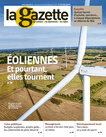Depuis l’entrée en vigueur du nouveau RFGP, les cadres territoriaux appellent à ce que soit reconnu un « droit à l’erreur ». Ce fut le cas au congrès de la Fédération nationale des centres de gestion, qui s’est tenu en juin, et à celui de l’Association des administrateurs territoriaux de France, en juillet. Mais de manière générale, alors que les pratiques managériales poussent dans le sens d’une plus grande autonomie et d’une responsabilisation de l’expérimentation et de l’innovation, le rapport à l’erreur et à l’échec reste ambigu au sein des collectivités.
Source de progrès collectif
Pourtant, l’erreur peut devenir une source de progrès individuel et collectif, pour peu que l’on en fasse un enjeu de management. « Il faut envisager le droit à l’erreur comme un investissement », affirme Jennifer Bindler, cheffe du service « relations sociales et conditions de travail » de Mulhouse (1 700 agents, 104 900 hab.). « Même si vous prônez l’erreur comme facteur de progression, il n’en reste pas moins que pour certains agents, cela ne marche pas car ils n’en tirent pas d’enseignement et la reproduisent », nuance Sébastien Duval, DGS de Moret-Loing-et-Orvanne (220 agents, 12 600 hab. ...
[90% reste à lire]
Article réservé aux abonnés
Gazette des Communes
Références
- Dans « Le droit à l’erreur. Les bons collaborateurs font des erreurs, les bonnes entreprises le permettent ! », paru en 2021 aux éditions Dunod, Séverine Loureiro, spécialiste de l’expérience collaborateur, propose des clés pour encadrer et tirer parti du droit à l’erreur.
Thèmes abordés