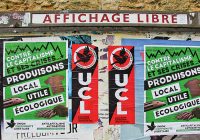Les rencontres ont eu lieu toute la journée du 20 juin, à l’université de Caen (Calvados), tout d’abord entre acteurs concernés par le développement industriel des énergies marines renouvelables (EMR) en Basse-Normandie puis, en soirée, avec le grand public.
Organisées par l’Institut régional du développement durable de Basse-Normandie (IRD2), association cofondée par la région Basse-Normandie et l’université pour « favoriser les liens entre chercheurs et acteurs du territoire », elles font suite à l’appel d’offres pour le premier parc éolien offshore français qui place la Basse-Normandie parmi les territoires porteurs du développement des EMR.
Tablant sur tous les potentiels énergétiques de la mer de la Manche, ces « premières rencontres sur les EMR et leur acceptabilité sociale » ont abordé l’éolien mais aussi l’hydrolien, l’énergie houlomotrice, l’énergie marémotrice.
Un point a été fait sur leur développement, sur leur impact, sur les moyens mis en oeuvre… et sur le concept d’acceptabilité sociale.
A l’appui des sciences humaines – Jean-Karl Deschamps, premier vice-président du conseil régional de Basse-Normandie, « nous sommes convaincus qu’aujourd’hui, il n’est plus possible de faire de grands investissements, de grandes infrastructures sans se soucier d’être en lien avec les préoccupations des citoyens et les besoins des usagers. »
Forte d’un pool de chercheurs en sciences humaines reconnu à l’international, la Basse-Normandie souhaite s’appuyer sur leur expertise pour accompagner et cultiver le dialogue, l’échange, et favoriser la meilleure intégration possible de la nouvelle filière industrielle que représentent les EMR.
Plus de 350 personnes ont participé aux tables rondes du 20 juin : entreprises, chercheurs, représentants des territoires et des services de l’Etat, associations, représentants des professionnels de la mer.
Veiller à l’intérêt général – Tous ont pu prendre conscience de cette volonté commune d’un développement des EMR dans le consensus. « Il y a une vingtaine d’années, évoque Jean-Karl Deschamps, les ingénieurs et techniciens se heurtaient souvent aux citoyens. On était plutôt dans l’affrontement. Aujourd’hui, il y a une réelle volonté de débattre et de travailler ensemble. »
Reste maintenant à « structurer la manière dont on dialogue ». S’il n’est plus question d’imposer des décisions, il faudra tout de même veiller à l’intérêt général, termine l’élu régional en rappelant notamment que la France s’est engagée à ce que les énergies renouvelables représentent au moins 23 % de la consommation nationale d’ici 2020.
Thèmes abordés
Régions