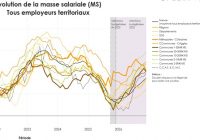1. LA TRISOMIE 21
La trisomie 21, appelée scientifiquement syndrome de Down est une anomalie chromosomique concernant une naissance sur 800 (59 % de garçons et 41 % de filles). Le risque d’avoir un enfant trisomique 21 augmente avec l’âge (une naissance sur 2 000 avant 30 ans, quatre sur 1 000 après 35 ans, une sur 50 après 45 ans).
Il s’agit d’un syndrome malformatif dans lequel une paire de chromosomes (dans ce cas, la 21e paire) porte un chromosome surnuméraire (appelé alors triplet).
Il existe trois formes de trisomie 21, la plus fréquente étant la trisomie 21 libre, complète et homogène qui représente environ 95 % des cas de trisomie 21.
a. Trisomie 21 libre, complète et homogène
Dans cette forme de trisomie 21, le caryotype s’écrit : 47, XX, + 21 s’il s’agit d’une fille, 47, XY, + 21 s’il s’agit d’un garçon.
- libre (s’oppose à translocation) : les trois chromosomes 21 sont séparés les uns des autres. Aucun n’est fusionné (collé à un autre chromosome) ;
- complète (s’oppose à partielle) : la trisomie concerne la totalité du chromosome 21 ;
- homogène (s’oppose à mosaïque) : la trisomie 21 a été observée dans toutes les cellules examinées au microscope ou qui ont fait l’objet d’un caryotype.
b. Trisomie 21 libre en mosaïque
Des cellules à 47 chromosomes, dont trois chromosomes 21, coexistent avec des cellules à 46 chromosomes dont seulement deux chromosomes 21. La proportion des deux catégories de cellules dépend de la date de l’accident dans l’organisme. Elle varie considérablement d’un sujet à l’autre et, chez le même individu, d’un organe ou d’un tissu à l’autre.
c. Trisomie 21 par translocation
Le caryotype montre deux chromosomes 21 libres, le troisième est fusionné, transposé sur un autre chromosome. Contrairement à ce qui est souvent dit, il n’existe pas de degrés dans la trisomie 21. En revanche, les manifestations sont plus ou moins importantes. Elles dépendent des gènes du chromosome 21 de l’enfant et de la manière dont il tolère les troubles métaboliques provoqués par les gènes en excès.
Les caractéristiques physiologiques sont facilement identifiables. Nous pouvons ainsi observer :
- une faiblesse du tonus musculaire : les acquisitions motrices et l’accès au langage s’effectuent plus tardivement et sont parfois perturbées. Des actions rééducatives appropriées sont alors nécessaires ;
- une hyperlaxité articulaire : articulations trop lâches pouvant provoquer des entorses ;
- un visage arrondi, un nez dont la racine est aplatie, des yeux bridés dont les paupières sont fendues obliquement, des petites oreilles, une petite bouche, un cou court, de petites mains, des doigts courts.
Plus insidieux est le ralentissement de l’influx nerveux (provoqué par une insuffisance de l’acetylcholine des neuromédiateurs et du métabolisme de la sérotonine) provoquant un ralentissement des connexions synaptiques et, plus concrètement, des difficultés de transmissions de l’ensemble des informations traitées par notre cerveau. C’est ce ralentissement qui induit notamment des difficultés de compréhension et qui nous laisse parfois penser que les personnes trisomiques 21 sont têtues et qu’il est nécessaire de leur répéter sans cesse la même chose : il n’en est souvent rien. Il faut juste un peu plus de patience.
Des malformations sont fréquemment associées :
- des malformations cardiaques ou cardiopathies congénitales apparaissent dans 40 % des cas. Les plus courantes correspondent à une communication anormale entre l’oreillette et le ventricule caractérisée par une peau « marbrée » ou un bleuissement des commissures des lèvres (particulièrement pas temps froid). Ces malformations rendent plus vulnérables la personne atteinte de trisomie 21 aux efforts intensifs. Ces malformations sont maintenant bien diagnostiquées et sont souvent opérées dès la naissance ;
- des malformations oculaires caractérisées par une cataracte, un strabisme ou une opacité du cristallin ;
- des malformations du squelette caractérisées par des malformations des premières vertèbres cervicales, des scolioses notamment ;
- des malformations digestives : sténose duodénal (rétrécissement du duodénum au niveau de l’intestin) ou maladie d’Hirschsprung (anomalie de fonctionnement de la partie terminale de l’intestin se traduisant par une constipation pouvant conduire à une occlusion intestinale). Sur le plan intellectuel, la déficience intellectuelle est présente chez la grande majorité des personnes atteintes de trisomie 21. Toutefois, outre le capital génétique, les compétences varient en fonction de l’éducation, des apprentissages mis en place, de l’environnement, notamment familial.
Chez l’enfant, les acquisitions sont souvent lentes et se font par paliers.
Ces dernières peuvent sembler parfois longues et peuvent être sources de découragement.
d. L’accompagnement
Malgré l’ensemble de ces caractéristiques, chaque personne porteuse d’une trisomie 21 est singulière et se développe de manière unique. L’ensemble de la population atteinte de trisomie 21 ne peut donc être considérée comme un groupe homogène. Il est ainsi difficile de préconiser un accompagnement qui soit à la fois adapté à des besoins spécifiques et généralisables. L’adaptation sociale, scolaire et professionnelle est néanmoins facilitée par la mise en place d’une adaptation de la pédagogie, des dispositifs de scolarisation et d’un accompagnement approprié.
L’espérance de vie des personnes trisomiques augmente régulièrement (en quinze ans, elle est passée de 25 à 49 ans et leur longévité continue à progresser de 1,7 an par an en moyenne). Ces personnes qui étaient considérées comme inéducables jusque dans les années 70, sont aujourd’hui capables de s’insérer dans notre société.
2. LE SYNDROME DE L’X FRAGILE
Le syndrome de l’X fragile est une anomalie génétique présente sur un chromosome X. Garçons et filles peuvent être atteints, mais l’expression du handicap est plus importante chez les garçons. La prévalence est d’un garçon sur 5 000 et d’une fille sur 9 000 environ. La déficience intellectuelle est légère à sévère, parfois inexistante. 10 % seulement des individus qui présentent ce syndrome ont une déficience intellectuelle profonde. Les troubles du langage sont fréquents, de même que les problèmes d’attention et l’hyperactivité. Des traits de comportement comme l’anxiété sociale et les conduites d’automutilation apparaissent parfois.
Le syndrome de l’X fragile constitue la première cause de retard mental héréditaire et la deuxième cause de retard mental d’origine génétique après la trisomie 21. Il résulte de la répétition d’un fragment de la chaîne ADN en un point précis d’un chromosome X s’amplifiant au fil des générations et, ainsi, le fragilisant. L’anomalie génétique évolue alors progressivement d’un état « prémuté » à un état dit de « mutation complète ». Si la pré-mutation reste stable en cas de transmission par le père, la mutation complète apparaît lors de la transmission par une mère prémutée à ses enfants. Plusieurs enfants d’une même fratrie peuvent donc être atteints du syndrome de l’X fragile.
Les symptômes et leurs conséquences sont variables chez le garçon et la fille. Chez la fille, la pathologie s’exprime de manière atténuée et, de ce fait, le diagnostic est rendu plus difficile. Chez la moitié des filles atteintes de l’X fragile, il n’existe aucun signe apparent.
Chez le garçon, nous pouvons observer :
- un retard moteur dû à une hypotonie ;
- une croissance du périmètre crânien parfois augmentée ;
- des aspects particuliers du visage plus facilement reconnaissables chez le grand enfant : le visage est allongé, le front est grand, la mâchoire est souvent allongée, les oreilles sont souvent grandes…
Les premiers signes d’alertes apparaissent vers l’âge de 3-4 ans sous la forme :
- d’un retard du langage (dysphasie) ;
- d’une agitation motrice pouvant se manifester sous la forme d’une impulsivité, d’une hyperactivité et d’un déficit de l’attention ;
- de la dyspraxie : difficultés à coordonner ses mouvements de manière automatique entraînant des troubles du graphisme, de l’écriture et du calcul ;
- de troubles des interactions sociales pouvant se manifester sous la forme d’une fuite du regard, parfois d’activités stéréotypées de type autistique (battements des mains, cris, auto-agressivité, hétéro-agressivité, crises d’anxiété). Ces manifestations se déclenchent lorsqu’il y a interactions sociales ou quand la sphère émotionnelle ou sensorielle (bruit, contact, stimuli visuels) est trop mobilisée. Aussi, dans un cadre rassurant, on observe souvent des interactions de qualité.
La déficience intellectuelle est plus souvent modérée que sévère. Elle engendre :
- des troubles du langage où la prononciation est difficile, la parole précipitée et laissant apparaitre de l’écholalie (répétition systématique de la fin de la phrase). La compréhension du langage est souvent meilleure que l’expression ;
- le raisonnement est troublé et difficile et demande à être aidé d’un support visuel ;
- la mémoire visuelle est plus efficace que la mémoire verbale. Chez la fille, le syndrome s’exprime de façon plus insidieuse et, dans la moitié des cas, sans signes apparents. Les premiers signes apparaissent à l’école primaire avec des troubles du calcul alors que le langage écrit est correct, des difficultés de mémoire verbale, parfois de la dyspraxie. Les troubles des interactions sociales sont plus légers que chez le garçon et se manifestent par de la timidité, une inhibition fréquente induisant des difficultés dans les relations sociales.
Suggestions de sites internet
http://www.unapei.org/ : site de l’UNAPEI pour s’informer sur le handicap mental.
http://www.trisomie21-france.org/ : site d’information sur la trisomie 21.
http://www.xfra.org/ : site de l’association nationale du syndrome de l’X fragile.
Éléments de bibliographie
CÉLESTE B. & LAURAS B. (2001), Le jeune enfant porteur de trisomie 21, Paris, Nathan.
CUILLERET M. (2003), Trisomie 21 : aides et conseils, Paris, Masson.
LAFLEUR L. (1993), Le langage de l’enfant trisomique 21, Montréal, Éditions de l’hôpital Sainte-Justine.
LEJEUNE-PHÉLIPOT F. (2003), Comment vivre avec un enfant trisomique, Paris, éditions Josette Lyon.
MICHELET A., WOODILL G. (1993), Le Handicap dit mental : le fait social, le diagnostic, le traitement, Paris, Delachaux et Niestlé.
PERRON R. (2004), L’intelligence de l’enfant et ses troubles. Des déficiences mentales de l’enfance aux souffrances de la personne, Paris, Dunod.
VAGINAY D. (2005), Découvrir les déficiences intellectuelles, Toulouse, Érès.
Thèmes abordés