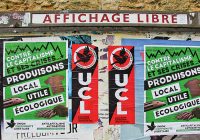« Le monde rural est moins en train de dépérir que de changer de fonction », dépeint Laurent Davezies, économiste, en introduction de sa note « Le monde rural : situation et mutations », parue le 7 juillet 2017 pour Terra Nova, le think tank marqué à gauche.
Une ruralité en mouvement, un phénomène qui n’a rien de nouveau
Interrogé par La Gazette des Communes, Pierre-Marie Georges, géographe au Laboratoire d’études rurales de Lyon, nuance un tel constat : « Oui, le monde rural change, mais il a toujours changé ! L’analyse dans le temps long montre que les espaces ruraux, ses acteurs, et ses populations sont depuis toujours mobiles et en interrelation avec les espaces environnants ».
En raison du « recul général » de l’emploi salarié et de la fracture numérique qui touchent ces 18 311 communes, soit 9,7 millions d’habitants et 55 % du territoire national, l’économiste Laurent Davezies estime que le monde rural peut néanmoins se sentir « orphelin de la solidarité entre les territoires ».
Non, les territoires ruraux ne sont pas abandonnés
Le géographe Pierre-Marie Georges se méfie, pour sa part, d’une telle description : « la généralisation de la thématique de l’abandon à l’ensemble des territoires ruraux peut procéder d’une rhétorique urbano-centrée, héritière d’une longue tradition d’images négatives associées à ce que certains auteurs ont appelé l’exode rural ».
Paradoxalement dans le même temps, Laurent Davezies assure que ce sentiment est « largement amorti par les fortes solidarités fonctionnelles et redistributives » du monde urbain.
Un constat que partage Pierre-Marie Georges : « la ville polarise un certain nombre d’activités, d’emplois et de services qui, s’ils ne sont pas présents dans les villages ruraux, irriguent et dynamisent un espace plus vaste que l’on appelle aujourd’hui un bassin de vie ».
D’ailleurs, selon Laurent Davezies, 47 % des actifs du monde rural travaillent dans le monde urbain de même que le nombre de retraités, souvent dotés d’épargne, ne fait que croître (220 000 venus de la ville entre 2006 et 2012). Un constat qui fait dire à l’économiste que la crise ressentie est « amortie » du fait de cette « solidarité fonctionnelle ».
« Le rural d’aujourd’hui éclaire la ville contemporaine »
Pierre-Marie Georges préfère s’amuser d’un tel constat en renversant la perspective : « Interrogeons-nous sur d’éventuelles fonctions redistributives du monde rural vers la ville ! Le jardinage, par exemple, qui était une pratique villageoise, a gagné les centres-villes avec l’émergence des principes de la nature en ville (jardins partagés…) comme une réponse aux tensions sociales ».
Ce géographe assure ainsi qu’« on peut même penser que le rural d’aujourd’hui éclaire la ville contemporaine » ajoutant : « il peut devenir un espace support d’expérimentations et d’innovations sociales, notamment à partir de l’initiative locale ».
En clair, selon Pierre-Marie Georges, il est temps de réconcilier les mondes urbain et rural : « les initiatives sont nombreuses, en campagne et en ville, pour associer nature et société, dans une optique démocratique, raisonnable, intelligente, réversible et ancrée localement. En ce sens, les campagnes françaises sont un laboratoire du futur ».
Thèmes abordés