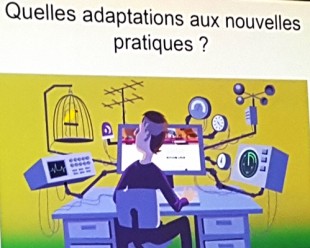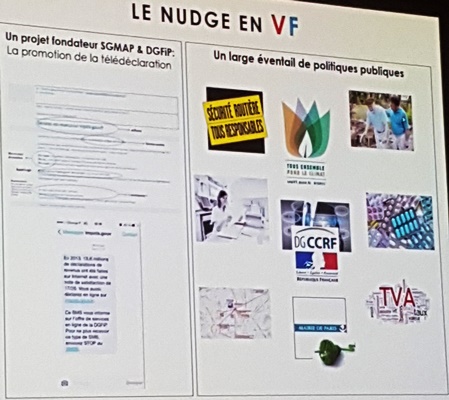La première journée d’étude du 29e Congrès de l’AATF a été à maintes reprises l’occasion pour les congressistes et intervenants de manifester leur agacement à voir le Gouvernement ouvrir l’accès aux postes de direction générale aux contractuels sans quota ni limite et, de façon plus générale, à recentraliser.
Les travaux du mardi matin, bien que sur le papier très clairement fléchés « sciences », se sont finalement révélés encore plus sévères. Aussi bien l’ intervention d’un paléontologue que celle d’une chercheuse en neurosciences cognitives ont permis aux doutes et crispations de s’exprimer… non sans humour parfois.
L’avenir paléontologique de la fonction publique
« Vous, les fonctionnaires territoriaux, vous n’êtes pas une espèce en voie de disparition ». C’est un paléontologue qui l’affirme, en s’appuyant sur la « Loi Cope-Doperet ». Une loi qui veut que plus une espèce grandit, plus elle approche de sa fin. Or les chiffres de la fonction publique sont clairs : si le nombre de fonctionnaires a augmenté, de 0,2 % entre 2002 et 2013, il a considérablement baissé si on le compare à l’augmentation globale de la population, de l’ordre de 6, 8 %.
Vous êtes donc sauvés mais, comme toute espèce, condamnés à évoluer encore
« Vous êtes donc sauvés mais, comme toute espèce, condamnés à évoluer encore » a expliqué, un brin malicieux Francis Duranthon, Directeur du Muséum d’histoire naturelle de Toulouse Métropole. Car selon une deuxième loi scientifique, toute espèce engagée dans une direction évolutive déterminée ne peut plus revenir en arrière. Et vous évoluez, nécessairement, car « les cadres d’interprétations d’aujourd’hui ont évolué », faisant une allusion à peine dissimulée à la » disruption ».
Pour terminer sa démonstration, Francis Duranthon s’appuie sur une troisième et dernière loi, celle de Léthiers qui énonce qu’une évolution peut être lente et indolore, s’étalant dans le temps avec des réformes successives… Mais l’évolution devient beaucoup radicale et violente, si l’espèce est poussée dans des « zones d’inconfort » et contrainte à l’innovation.
Le temps de la décision
Les sciences neurocognitives peuvent enrichir, mais non remplacer l’action publique : Mariam Chammat, chercheuse en neurosciences cognitives, collabore avec la Direction interministérielle à la transformation publique (DITP). Elle veut sortir de l’image du « Nudge », souvent réduite à la représentation d’une mouche incitative dans les urinoirs pour « jouer sur l’instinct de chasseur des hommes ».
Rapportées à l’action publique, les neurosciences cognitives permettent au décideur public de comprendre que l’information n’est jamais perçue de la même façon, chaque individu utilisant des « biais de sélection » : biais d’optimisme, biais de « sur confiance » ou biais de « statu quo ». La solution passe, selon la chercheuse, par l’engagement des interlocuteurs, la simplification et la transformation des formulaires et la « ludification ».
Mais surtout , « il faut savoir prendre en compte le contexte des décisions : des études ont montré que la décision des juges est toujours plus sévère avant leur déjeuner »…
LA DITP s’attache à définir un cadre éthique, assure-t-elle, dans l’utilisation qui pourra être faite des apports des neurosciences. Une précision utile, tant le débat organisé sur le recours au Nudge, a été vif : outil efficace d’influence ou atteinte insidieuse au libre arbitre éclairé de l’individu ?
Retour d’expérience d’un député dépité
Sébastien Nadot, député de la Haute Garonne est venu en clôture de Congrès , témoigner de son expérience parlementaire. Un rapport d’étonnement, tient-il à préciser : « La science, c’est la rationalité. Or il y a un manque de rationalité très inquiétant dans la procédure parlementaire. On est au contraire dans l’irrationalité » souligne le député » En marche ».
Le député de la majorité gouvernementale pointe une évaluation des politiques publiques inexistante, une participation à l’élaboration de la loi réduite à quelques amendements, acceptés par le gouvernement, et un contrôle de l’action du Gouvernement réduit peu à peu. Quel apport de la science dans l’action publique ? Il devrait être majeur selon Sébastien Nadot. « Mais les chercheurs se méfient désormais des décideurs publics, assimilés à des décideurs politiques … »
Les meilleures décisions sont celles prises au plus proche de là où elles auront des conséquences, explique le député. Mais il constate que la voie empruntée est celle d’une recentralisation pyramidale. C’est le « témoignage inquiet d’un « député expérimental », qui essaye de prendre ses décisions en fonction de l’intérêt général. Un exercice rendu difficile», reconnaît-il.