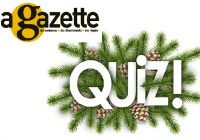Au moment où l’application des 35 heures dans la fonction publique fait l’objet d’un rapport très attendu, alors que le Sénat et l’Assemblée nationale peinent à trouver un accord sur la restauration du jour de carence, il faudrait regarder d’un peu plus près ces avantages qui ont aussi leurs inconvénients, et ces avancées qui peuvent cacher quelques reculs en matière d’égalité de traitement des fonctionnaires.
S’agissant de la durée hebdomadaire du travail, on rappellera que celle-ci repose, pour la fonction publique territoriale, sur des dispositions législatives et réglementaires qui ne tolèrent aucune ambiguïté. Or, dès sa mise en œuvre dans les collectivités territoriales, ce dispositif a généré de graves inégalités.
Inégalité entre les collectivités qui avaient instauré un régime plus favorable avant le 4 janvier 2001, date de publication de la loi, et qui ont pu le conserver en invoquant la clause de sauvegarde ; et toutes les autres soumises au droit commun.
Inégalité entre les grandes collectivités, capables de mobiliser quelques réserves de productivité et de procéder, le cas échéant, aux recrutements de compensation nécessaires ; et toutes les autres, notamment les petites communes, contraintes de jongler avec les agents à temps non complet et autres supplétifs.
Effets du jour de carence
Inégalité, donc, entre les fonctionnaires territoriaux d’une collectivité à une autre. Car, c’est de manière tout à fait aléatoire qu’un certain nombre de protocoles de réduction du temps de travail ont été négociés et délibérés, certaines collectivités n’ayant pas hésité à adapter les chiffres pour offrir un meilleur sort à leurs agents. Quelques-unes ont été invitées à refaire leurs calculs.
D’autres ont échappé à la censure et ont pu maintenir des régimes qui constituaient de véritables rentes de situation pour leurs agents, un avantage sur lequel les exécutifs concernés s’efforcent de revenir, non sans difficultés.
S’agissant de l’absentéisme, il serait bon d’en rechercher les causes sans se contenter d’invoquer la pyramide des âges ou la pénibilité des missions et des tâches. La suppression du jour de carence, à compter du 1er janvier 2014, a constitué, en matière de congés de maladie ordinaire, une incitation dont les effets ont été confirmés par une étude de Sofaxis : 54 arrêts maladie pour 100 agents, en 2014, contre 48 en 2013. Par ailleurs, en ne rémunérant pas le premier jour d’absence, les employeurs locaux avaient économisé 40 millions d’euros en 2012.
Pour atténuer les effets de la suppression du jour de carence, les contrôles devaient être renforcés, ce dont on peut douter lorsqu’on connaît la procédure qui encadre ces démarches. Pour cette raison (et pour d’autres), peu de collectivités pratiquent le contrôle systématique, préférant s’en remettre aux vertus de l’assurance pour compenser la perte financière. Ainsi l’objectif qui consiste à reconstituer un « potentiel de présentéisme » ne sera pas atteint ; et l’absentéisme reprendra sa progression, avec une prédilection pour ces petites absences, trop souvent négligées, mais qui ont pour effet de déstabiliser un service, lorsque les plus assidus des agents se partagent les tâches des plus absents, ce qui est vécu comme un facteur d’inégalité.
Pour éviter que la décentralisation, qui doit être diversifiée, ne verse dans le désordre, il importe de réduire les inégalités les plus criantes, tout en se gardant de prendre des initiatives qui peuvent en créer d’autres.