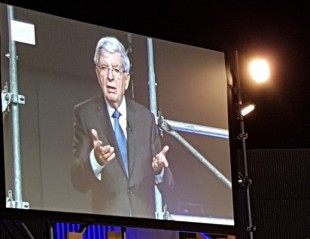Liberté, égalité, fraternité. Que valent les valeurs de la République aujourd’hui ? La question faisait l’objet d’un atelier des vingtième entretiens territoriaux de Strasbourg. Les organisateurs (1) avaient pour l’occasion demandé à un professeur de renom de venir donner son sentiment en la personne de Jean-Pierre Chevènement.
L’ancien ministre, républicain convaincu, ne s’est pas privé de donner un véritable cours de sciences politiques au parterre de territoriaux venu l’écouter. Il a réexpliqué les fondamentaux de la République à ceux qu’il qualifie de « visage du service public de notre pays » pour les aider à mieux incarner ces valeurs sur le terrain. « Si on reste trop abstrait, on ne comprend pas ce dont il est question » a-t-il averti. Ces valeurs que sont la liberté, l’égalité et la fraternité « ne valent que si on garde à l’esprit leur cohérence », selon l’ancien ministre.
La liberté … dans le cadre de la loi
La liberté n’est pas l’anarchie, mais bien celle que l’on peut exercer dans le cadre de la loi, elle-même expression de la volonté du peuple souverain, a recadré l’ancien maire de Belfort. Concrètement pour le citoyen, ce principe se traduit par la liberté de faire tout ce qu’il veut… à partir du moment où ce qu’il fait n’est pas interdit. Mais ce principe s’articule avec celui d’égalité, défini par Jean-Pierre Chevènement, comme une « égalité des chances, une égalité devant le service public, et donc devant ses prestations ». C’est cet ensemble qui permet par exemple de refuser toute discrimination, qu’elle soit ethnique, sexuelle, religieuse, a-t-il mis en perspective.
Le principe d’égalité, c’est l’égalité des chances, une égalité devant le service public, et donc devant ses prestations
Un outil de lutte contre les discriminations
Le système permet ainsi de déconstruire certaines postures. Les discriminations religieuses existent depuis des siècles, l’Edit de Nantes avait tenté d’y mettre fin, sa révocation a été funeste pour le pays, a rappelé l’actuel président de la Fondation de l’Islam de France. Depuis, la France a progressé sur l’échelle de la tolérance, juge l’ancien ministre, en particulier avec le principe de laïcité « qui n’exclut pas qu’un individu trouve des motivations religieuses dans son action, mais qui fait que celles-ci n’ont pas à s’exprimer dans le débat public. La République demande seulement aux religions de ne pas imposer leur dogme dans le débat public ».
La République demande seulement aux religions de ne pas imposer leur dogme dans le débat public
Cette posture, selon l’ancien élu local, n’empêche pas de prendre en compte certains facteurs culturels et de trouver certaines solutions par exemple pour les repas dans les cantines scolaires (en ne servant pas uniquement de la viande porc dans un menu, en séparant les aliments…). Elle permet aussi de « résister » à ce qui relève de « pressions communautaires » conduisant à des situations « inadmissibles » comme le refus pour une femme de se faire soigner par un homme à l’hôpital ou pour un homme de conduire un bus après une femme.
Le service public pour civiliser plus encore
Quant à la fraternité, qui subsiste via la sécurité sociale, la gratuité de l’école, les allocations familiales…, elle implique du civisme, au sens du respect de la loi : « le citoyen a des droits, mais aussi des devoirs, a sermonné Jean-Pierre Chevènement. Les valeurs de la République sont des valeurs immenses. La citoyenneté ne va pas sans quelques abnégations ».
Charge aux territoriaux de « mobiliser » toutes leurs « capacités d’intelligence » avec les élus pour continuer proposer un service public qui permette à une société civilisée de se civiliser encore plus
Mais charge aux territoriaux de « mobiliser » toutes leurs « capacités d’intelligence » avec les élus pour continuer à leur proposer un service public qui « permette à une société civilisée de se civiliser encore plus ».
Cet article est en relation avec les dossiers
- Laïcité, liberté religieuse : le point juridique
- Le statut de la fonction publique, flexible malgré tout
Thèmes abordés
Notes
Note 01 Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et l’Institut National des Etudes Territoriales (Inet) Retour au texte