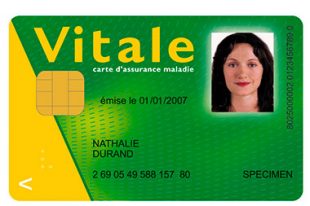Quelles juridictions traitent les contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale ?
Après la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, le contentieux général et technique de la sécurité sociale et celui de l’admission à l’aide sociale sont traités par les pôles sociaux des 116 tribunaux de grande instance (TGI) et des 28 cours d’appel spécialement désignés par décret.
Ils jugent les réclamations des bénéficiaires, des cotisants et des employeurs à l’encontre des décisions des organismes de sécurité sociale (Urssaf, CAF, CPAM, etc.), des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ainsi que les décisions des autorités administratives intervenant dans le domaine de l’aide sociale (code de l’organisation judiciaire, art. L.211-16, L.311-15, L.311-16, annexe des articles D.211-10-3 et D.311-12-1).
Comment s’organise le recours préalable ?
Le recours préalable est obligatoire. Les réclamations d’ordre administratif et celles d’ordre médical après expertise sont présentées à la commission de recours amiable (CRA). Les demandes relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles sont examinées par la commission médicale de recours amiable (CMRA).
Les requérants disposent de deux mois à compter de la notification régulière de la décision de la CRA ou de la CMRA pour saisir le TGI. Le défaut de réponse, par la CRA pendant deux mois après réception de la demande ou de la complétude du dossier, et par la CMRA pendant quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Le recours préalable contre une décision de la CDAPH ou du président du conseil départemental s’exerce conformément au code de l’action sociale et des familles (code de la sécurité sociale (CSS), art. R.142-1 à R.142-7 et R.147-8, R.142-8-1 à R.142-8-7, R.142-9).
Quelle procédure s’applique en première instance ?
Les demandes sont formées, instruites et jugées, au fond et en référé, dans le cadre du code de procédure civile (CPC). L’aide juridictionnelle peut être demandée pour toute décision intervenue à compter du 1er janvier 2019.
La procédure est orale mais les parties peuvent renvoyer à un écrit qui reprend leurs demandes et arguments. La représentation par avocat n’est pas obligatoire. Sauf dérogations, le TGI compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire, de l’employeur ou du cotisant intéressé, ou, en cas de contestation, celui du défendeur.
Le TGI est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception qui doit mentionner l’article 58 du CPC, exposer sommairement les motifs de la demande et être accompagnée de ses justificatifs. La décision du TGI est notifiée aux parties.
Le président du TGI statue, dans le cadre d’une injonction de payer, sur le recouvrement d’une créance résultant d’une prise en charge injustifiée ou d’un indu de prestation (CSS, art. R.142-10, R.142-10-1, R.142-10-4, R.142-10-7, R.142-10-8, R.142-1-A ; CPC, art. 446-1).
Comment contester la décision de justice ?
La décision du TGI peut être contestée en appel pendant le mois qui suit sa notification par le greffe (15 jours en référé). La représentation par avocat n’est pas obligatoire en appel. Une procédure spécifique (CSS, art. R.142-13 et s.) s’applique aux litiges relatifs à l’incapacité et à la tarification en matière d’accidents du travail.
Un pourvoi en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort par le TGI et les arrêts de cour d’appel peut être présenté par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Le pourvoi est instruit et jugé selon les règles ordinaires quand elles ne sont pas contraires aux dispositions des articles R.142-1-A et suivants du CSS (CSS, art. R.142-11, R.142-15).
Comment sont traitées les procédures en cours ?
Les procédures en cours, de première instance et d’appel, ont été transférées, selon les cas, au TGI ou au tribunal administratif, à la cour administrative d’appel (CAA) de Paris ou à la cour d’appel spécialement désignée. Il est fait appel des décisions rendues avant le 1er janvier 2019, selon les cas, devant la cour d’appel spécialement désignée ou la CAA de Paris (décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, art. 16).
Thèmes abordés